Par la fenêtre, le ciel, déchiré, nous tombe dessus. Dans mon dos, le salon est une chambre. La famille s’y entasse et s’endort dans sa propre chaleur. La rue est devenue invisible. Les arbres s’étendent et barrent les chemins. La neige se pressent à descendre pour couvrir la glace de la pluie qui a figé le quartier. Le plancher à l’air en feu. Le foyer brûle toujours. L’odeur de la forêt dans le salon.
Les vagues se brisent sur les immenses roches vertes de la rive. La marée s’étend et ne veut pas se retirer. Elle tarde. Les arbres presque sans feuille grattent le sol humide sans casser. Ils se relèvent brusquement et se replient ensuite. Le vent gratte la maison et la fait gémir. Il n’y a pas de pluie, mais la mer nous fait sentir le contraire sous son haleine salée et humide.
Des coups de fusil – Ils sont à blanc, je le sais. Mes jambes sont molles à cause du sol qui tremble. Ne pas détacher mes yeux des ces gens que je ne connais pas, mais qui se marient. Le prêtre crie pour faire oublier les bombes – fausses, juste le bruit – qui tombaient à dix kilomètres. Tout le monde a pensé à l’ironie du sort. Le sifflement de la guerre – pas une vraie – arrivait par la longue côte toute verte, sans arbres, et accablait les gens qui essayaient de s’aimer.
L'adolescence est plus claire ; les films que nous allions voir mes amis, P. et moi ; les journées interminables de nos étés durant lesquelles l'envie des cigarettes ne flottait pas encore partout, tout le temps ; et puis les jours plus clairs pour lesquels la mémoire s'éclaircit, où toute ma vie se tient maintenant. Le plus souvent, des odeurs s'attachent au passé et me le rapatrient à coup d'hiver qui commence, de ragoût qui bout dans la cuisine fumante, de parfum que je connais sans savoir pourquoi et d'herbe coupée au soleil. Mais c'est à l'aide des mots que je me souviens de P. ; une phrase qui reste et que l'écho ramène parfois ; et les expressions qui sonneront toujours faux dans la bouche des autres. Je n'ai jamais su ce qu'il y avait dans nos mots, ceux qui sont restés imprimés dans nos têtes, ni pourquoi notre mémoire s'y jetait avec une telle aisance. Nous ne lisions pas à outrance ; seulement ce que nos cours de français nous imposaient. Pourtant, c'est tout un lexique qui a constitué notre amitié.
Il ne me reste de l'école secondaire que l'ampleur réduite de l'intérêt que j'y accordais à cette période. Les moments ne sont pas particulièrement clairs, mais ils sont là. Le cégep ne s'est pas imprimé plus profondément en moi, simplement, il y a toute une vie dans ces deux périodes qui rend les souvenirs étranges. C'est le changement que nous partagions P. et moi ; les questions ; l'incertitude et les tremblements qu'on retient. C'est toujours l'ensemble d'une vie que rappelle un souvenir, aussi court qu'il puisse être. Tout se retourne sur soi-même et il me reste l'ensemble des regards que j'ai portés sur mes jours, parallaxe de la mémoire. Celle de P. aussi.
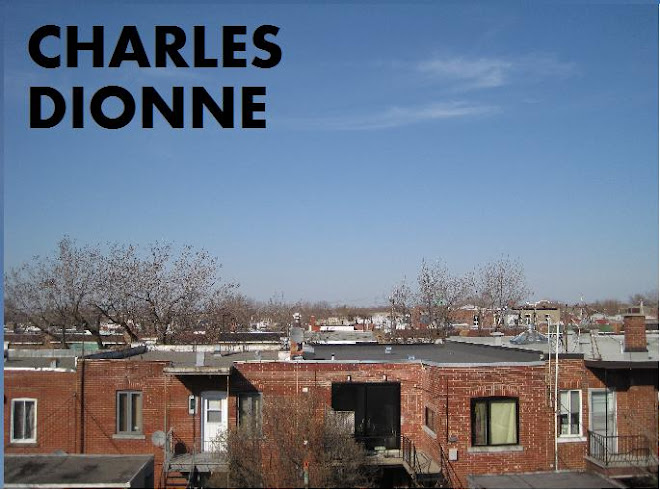



Aucun commentaire:
Publier un commentaire